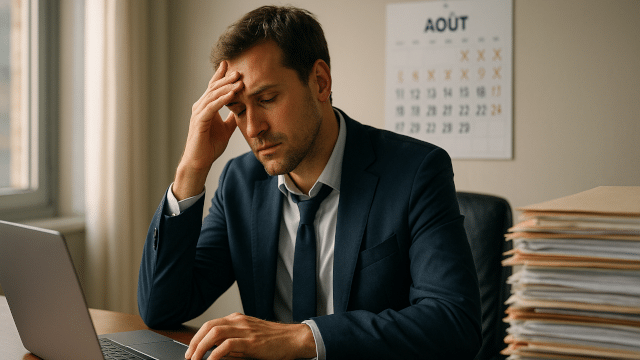Le congé payé : un droit fondamental… mais une réparation sous condition
Le droit au repos constitue une garantie essentielle du droit du travail, encadrée par la loi et par le droit européen. L’employeur est tenu non seulement d’accorder les congés, mais aussi d’en permettre concrètement la prise. Toutefois, que se passe-t-il lorsque le contrat prend fin et que le salarié n’a pas pu profiter de ses jours de repos ? Si l’indemnité compensatrice est systématiquement due, peut-il également réclamer des dommages intérêts ? Dans un arrêt remarqué rendu le 11 mars 2025 (n° 23-16.415), la Cour de cassation répond avec fermeté : sans preuve de préjudice distinct, pas d’indemnisation complémentaire.
Le droit applicable : entre repos obligatoire et prévention des risques
Le Code du travail, à son article L. 3141-1, ouvre droit à un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrables par mois travaillé. Ce droit s’inscrit dans un ensemble plus large d’obligations pesant sur l’employeur, notamment celles de protection de la santé physique et mentale du salarié (articles L. 4121-1 et L. 4121-2). À l’échelle européenne, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 consacre le congé annuel comme un impératif de santé publique. Ces textes imposent à l’employeur une véritable organisation du repos de son personnel, sous peine de sanction. Mais le régime de cette sanction est précisément ce qu’interroge l’arrêt de 2025.
Une jurisprudence de plus en plus exigeante
Depuis plusieurs années, la Cour de cassation affine sa position. En 2017 déjà, elle exigeait de l’employeur qu’il prouve avoir effectivement permis au salarié d’exercer son droit à congé. En 2023, elle allait plus loin, en affirmant que l’indemnité compensatrice de congés payés pouvait suffire à réparer le manquement, à condition qu’aucun autre dommage ne soit démontré. L’arrêt du 11 mars 2025 parachève cette construction : la réparation automatique est exclue. Le salarié doit prouver avoir subi un préjudice distinct, réel et concret, pour espérer une indemnisation supplémentaire.
L’affaire jugée en 2025 : congés non pris et absence de preuve du préjudice
La salariée en cause, gardienne d’immeuble, n’avait pu prendre ses congés en 2016 avant son licenciement en juillet de la même année. Elle reprochait à son employeur de ne pas l’avoir sollicitée à ce sujet et réclamait des dommages-intérêts en plus de l’indemnité compensatrice de congés payés perçue. La Cour rappelle d’abord que l’employeur est tenu d’organiser les congés et de justifier de ses diligences. Mais elle affirme surtout que l’indemnité compensatrice règle déjà le sort des jours non pris. Pour obtenir une réparation complémentaire, la salariée aurait dû prouver un préjudice autonome : atteinte à la santé, perte d’une opportunité ou désorganisation familiale, par exemple. Or, rien de tout cela n’était établi. Le juge de cassation valide donc le rejet de sa demande indemnitaire.
Conclusion : entre droit au repos et charge de la preuve
En posant clairement que le préjudice lié à la non-prise de congés n’est pas automatique, l’arrêt du 11 mars 2025 réaffirme un principe fondamental du droit de la responsabilité : pas de réparation sans preuve du dommage. L’indemnité compensatrice reste une réponse normale et suffisante au manquement à l’obligation d’organisation des congés. Ce n’est que dans les cas les plus graves, ceux où le salarié démontre un préjudice concret (par exemple, une dégradation de son état de santé par la production d’éléments médicaux), que le juge accordera éventuellement une réparation supplémentaire.
Cette décision est conforme au principe de droit français de réparation des préjudices subis : « tout le préjudice, mais rien que le préjudice ».
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 2025, no 23-16415
PB Avocats